Flash info
Fermeture du musée
Le musée Stéphane Mallarmé est actuellement fermé au public. Réouverture du 2 mai au 14 juillet 2026. Réservation pour les groupes toute l'année sous réserve de disponibilité par mail ou par téléphone.
Actualités

Créé le:
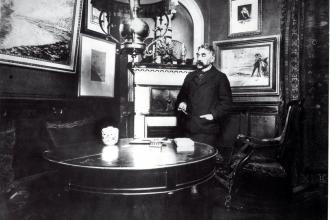
Étienne Mallarmé, dit Stéphane, naît à Paris le 18 mars 1842 et passe les premières années de sa vie, chéri par sa mère, Élisabeth Desmolins, et ses grands-parents maternels. La santé de sa mère décline et elle meurt en 1847 ; Stéphane et sa sœur Maria sont confiés à leurs grands-parents, tandis que leur père se remarie l'année suivante. Après une scolarité difficile, il devient pensionnaire au lycée impérial de Sens en 1856. Resté très proche de sa sœur, son décès l'année suivante à seulement 13 ans le marquera profondément. Le jeune Stéphane se réfugie alors dans la poésie et compose ses premiers poèmes influencés par Victor Hugo, Alfred de Musset ou encore Alphonse de Lamartine, qu'il rédige à la main et regroupe dans un cahier qui deviendra son premier recueil intitulé Entre quatre murs.
Issu d'une famille de fonctionnaires, Mallarmé va tout faire pour se soustraire à cette carrière dans l'administration comme il l'écrira dans la célèbre lettre autobiographique à Verlaine en 1885 : « Mes familles paternelle et maternelle présentaient, depuis la Révolution, une suite ininterrompue de fonctionnaires dans l’Administration de l’Enregistrement ; et bien qu’ils y eussent occupé presque toujours de hauts emplois, j’ai esquivé cette carrière à laquelle on me destina dès les langes. »
C'est dans ce sens, qu'il répond à son grand-père le 31 janvier 1862 : Mon cher bon Papa,
Après la lecture de ta lettre d'hier, je ressentis en moi une grande tristesse. Il me semblait que tu me disais : « je te permets de faire ceci, seulement si tu le fais tu me chagrineras et je ne serai pas content de toi. » Ce qui me semblait pire que : « Je te le défends. » Ce seulement me torturait.
Maman m'a rassuré en me disant qu'il ressortait de ta lettre ainsi que de celle de ma chère bonne maman que, sans m'encourager aucunement, vous me laissiez libre.
J'ai donc parlé au professeur d'anglais de Sens, un homme déjà mûr déjà, et qui, paraît-il, a une excellente méthode. Il viendrait cinq fois par semaine, c'est-à-dire tous les jours, les jeudis exceptés, et ses leçons seraient d'une heure. Il me donnerait de nombreux devoirs, corrigerait les thèmes lui-même et me laisserait une traduction pour corriger les versions, afin de ne pas perdre du temps et de l'employer en leçons pratiques, grammaire, conversation.
Ce sera une dépense je le sais, mais ce sera moi qui la supporterai.
Mon receveur m'a juré que ce ne sera pas une raison une raison pour donner ma démission, j'aurais donc ainsi, en cas de grandes circonstances imprévues et mystérieuses, une porte ouverte sur l'Enregistrement jusqu'en juin, époque du premier examen. Quant à ce que tu me dis, cher bon Papa, parmi tes excellents conseils et tes observations sérieuses, que, livré à moi-même, je ne travaillerai pas assez, cela pourrait être vrai pour un travail qui ne me plût pas comme celui que j'entreprends, pour l'Enregistrement, par exemple travailler sans receveur. Et encore serai-je livré à moi-même ? J'aurai un professeur comme j'avais un receveur et je travaillerai huit ou neuf heures au lieu de deux ou trois. Enfin, cher bon Papa, je te mettrai au courant de toutes mes études, de mes progrès. Pour cela, je t'écrirai en anglais, et souvent, sans que tu aies à me répondre.

Je m'efforcerai de toute manière de me rendre digne de la liberté que vous me laissez, j'ai fait une liasse des lettres écrites à ce sujet par toi et bonne Maman pour les relire souvent et me donner courage, voyant que sur moi seul repose mon avenir.
Sois certain que mon travail et un jour mes succès te feront revenir des regrets que tu éprouves en ce moment, en songeant, comme eût fait ma pauvre mère que vous remplacez, à mon avenir, et que tu n'auras jamais à te repentir de ma décision. Tout ce que je dis, je le dis aussi à ma chère bonne Maman, que je confonds avec toi dans mon amour et ma reconnaissance. Adieu, cher bon Papa ; je t'embrasse de tout cœur, toi et bonne Maman.
Votre petit-fils qui vous aime,
Stéphane M.
Mallarmé découvre ensuite les célèbres Fleurs du mal de Charles Baudelaire, « extraordinaire et pur génie ». Bouleversé, Il traverse alors une période d’intense création. En 1863, il obtient son Certificat d'aptitude pour l'Anglais et sera muté dans plusieurs villes de province : Tournon, Besançon et Avignon. Entre 1863 et 1866, il rédige certains de ses poèmes les plus connus où l'on retrouve le style baudelairien : Brise marine, L'Azur, Les Fleurs...
La correspondance entre Mallarmé et son ami d'enfance le poète Henri Cazalis montre déjà ses exigences d'écriture afin d'atteindre cet idéal poétique qu'il recherchera toute sa vie : « Mon Henri, je t'envoie enfin ce poème de L'Azur que tu semblais si désireux de posséder. [...] Je te jure qu'il n'y a pas un mot qui ne m'ait coûté plusieurs heures de recherches [...] L'effet produit, sans une dissonance, sans une fioriture, même adorable, qui distrait, - voilà ce que je cherche. J'en suis sûr, m'étant lu ces vers à moi-même, deux cents fois peut-être, qu'il est atteint. Reste maintenant l'autre côté à envisager, le côté esthétique. Est-ce beau ? Y a-t-il un reflet de la Beauté ? » (Lettre à Henri Cazalis, janvier 1864).
Sur les traces de Baudelaire, Mallarmé découvre alors Edgar Poe qui deviendra son autre grande influence. Ayant appris l’anglais « simplement pour mieux le lire », il le considère comme son « grand maître » et traduira un grand nombre de ses œuvres dès les années 1860. Parallèlement, le poète s'attelle à une nouvelle œuvre dans laquelle il s'est mis « tout entier sans le savoir » : Hérodiade. L'écriture de ce poème témoigne de la crise intérieure que traverse Mallarmé dès 1866 et qui sera à l'origine de sa nouvelle conception poétique fondée sur l’abandon de tout but de représentation au profit d’un art de l’analogie et de la suggestion :
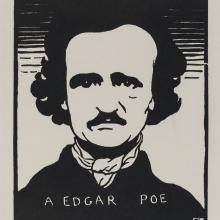
Un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clef.
Mallarmé continue à correspondre avec son ami poète au sujet d'Hérodiade : « Il me faudra trois ou quatre hivers encore, pour achever cette œuvre, mais j'aurai enfin fait ce que je rêve, écrire un poème digne de Poe et que les siens ne surpasseront pas. Pour te parler avec cette assurance, moi qui suis la victime éternelle du découragement, il faut que j'entrevoie de vrais splendeurs ! » (Lettre à Henri Cazalis, fin avril 1866).
Dix ans plus tard, Mallarmé collabora avec Edouard Manet qui illustre sa traduction du poème d'Edgar Poe Le Corbeau en 1875. En 1888, l’intégralité des traductions de Poe par Mallarmé est publiée dans un recueil illustré par Manet à qui l’ouvrage est dédié, l'année suivante une nouvelle édition du recueil parait que le poète dédiera à Baudelaire.
