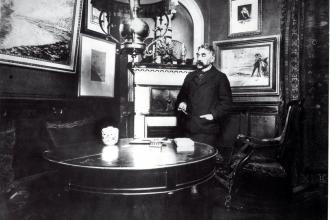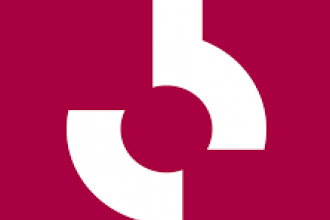J’avais beaucoup ramé, d’un grand geste net et assoupi, les yeux au dedans fixés sur l’entier oubli d’aller, comme le rire de l’heure coulait alentour. Tant d’immobilité paressait que frôlé d’un bruit inerte où fila jusqu’à moitié la yole, je ne vérifiai l’arrêt qu’à l’étincellement stable d’initiales sur les avirons mis à nu, ce qui me rappela à mon identité mondaine.
Qu’arrivait-il, où étais-je ?
Il fallut, pour voir clair en l’aventure, me remémorer mon départ tôt, ce Juillet de flamme, sur l’intervalle vif entre ses végétations dormantes d’un toujours étroit et distrait ruisseau, en quête des floraisons d’eau et avec un dessein de reconnaître l’emplacement occupé par la propriété de l’amie d’une amie, à qui je devais improviser un bonjour. Sans que le ruban d’aucune herbe me retînt devant un paysage plus que l’autre, chassé avec son reflet en l’onde par le même impartial coup de rame, je venais échouer dans quelque touffe de roseaux, terme mystérieux de ma course, au milieu de la rivière : où tout de suite élargie en fluvial bosquet, elle étale un nonchaloir d’étang plissé des hésitations à partir qu’a une source.
L’inspection détaillée m’apprit que cet obstacle de verdure en pointe sur le courant, masquait l’arche unique d’un pont prolongé, à terre, d’ici et de là, par une haie clôturant des pelouses. Je me rendis compte. Simplement le parc de Madame.., l’inconnue à saluer.
Un joli voisinage, pendant la saison, la nature d’une personne qui s’est choisi retraite aussi humidement impénétrable ne pouvant être que conforme à mon goût. Sûr, elle avait fait de ce cristal son miroir intérieur, à l’abri de l’indiscrétion éclatante des après-midis ; elle y venait et la buée d’argent glaçant des saules ne fut bientôt que la limpidité de son regard habitué à chaque feuille.
Toute je l’évoquais lustrale.
Courbé dans la sportive attitude où me maintenait de la curiosité, comme sous le silence spacieux de ce que s’annonçait l’étrangère, je souris au commencement d’esclavage dégagé par une possibilité féminine : que ne signifiaient pas mal les courroies attachant le soulier du rameur au bois de l’embarcation, comme on ne fait qu’un avec l’instrument de ses sortilèges.
— « Aussi bien une quelconque.. » allais-je terminer.
Quand un imperceptible bruit, me fit douter si l’habitante du bord hantait mon loisir, ou inespérément le bassin.
Le pas cessa, pourquoi ?
Subtil secret des pieds qui vont, viennent, conduisent l’esprit où le veut la chère ombre enfouie en de la batiste et les dentelles d’une jupe affluant sur le sol comme pour circonvenir du talon à l’orteil, dans une flottaison, cette initiative par quoi la marche s’ouvre, tout au bas et les plis rejetés en traîne, une échappée, de sa double flèche savante.
Connaît-elle un motif à sa station, elle-même la promeneuse : et n’est-ce, moi, tendre trop haut la tête, pour ces joncs à ne dépasser et toute la mentale somnolence où se voile ma lucidité, que d’interroger jusque-là le mystère !
— « À quel type s’ajustent vos traits, je sens leur précision, Madame, interrompre chose installée ici par le bruissement d’une venue, oui ! ce charme instinctif d’en dessous que ne défend pas contre l’explorateur la plus authentiquement nouée, avec une boucle en diamant, des ceintures. Si vague concept se suffit ; et ne transgresse point le délice empreint de généralité qui permet et ordonne d’exclure tous visages, au point que la révélation d’un (n’allez point le pencher, avéré, sur le furtif seuil où je règne) chasserait mon trouble, avec lequel il n’a que faire. »
Ma présentation, en cette tenue de maraudeur aquatique, je la peux tenter, avec l’excuse du hasard.
Séparés, on est ensemble : je m’immisce à de sa confuse intimité, dans ce suspens sur l’eau où mon songe attarde l’indécise, mieux que visite, suivie d’autres, ne l’autorisera. Que de discours oiseux en comparaison de celui que je tins pour n’être pas entendu, faudra-t-il, avant de retrouver aussi intuitif accord que maintenant, l’ouïe au ras de l’acajou vers le sable entier qui s’est tu !
La pause se mesure au temps de sa détermination.
Conseille, ô mon rêve, que faire.
Résumer d’un regard la vierge absence éparse en cette solitude et, comme on cueille, en mémoire d’un site, l’un de ces magiques nénufars clos qui y surgissent tout à coup, enveloppant de leur creuse blancheur un rien, fait de songes intacts, du bonheur qui n’aura pas lieu et de mon souffle ici retenu dans la peur d’une apparition, partir avec : tacitement, en déramant peu à peu, sans du heurt briser l’illusion ni que le clapotis de la bulle visible d’écume enroulée à ma fuite ne jette aux pieds survenus de personne la ressemblance transparente du rapt de mon idéale fleur.
Si, attirée par un sentiment d’insolite, elle a paru, la Méditative ou la Hautaine, la Farouche, la Gaie, tant pis pour cette indicible mine que j’ignore à jamais ! car j’accomplis selon les règles la manœuvre : me dégageai, virai et je contournais déjà une ondulation du ruisseau, emportant comme un noble œuf de cygne, tel que n’en jaillira le vol, mon imaginaire trophée, qui ne se gonfle d’autre chose sinon de la vacance exquise de soi qu’aime, l’été, à poursuivre, dans les allées de son parc, toute dame, arrêtée parfois et longtemps, comme au bord d’une source à franchir ou de quelque pièce d’eau.